Joseph Mitchell, un building de mots
Dans cette chronique littéraire, Frédéric vous présente une des facettes du génie littéraire de Joseph Mitchell.
Si vous ne connaissez pas encore Joseph Mitchell, il faut vous précipiter sur un de ses textes. Cet homme est New York, tout simplement. L’une de ses contributions intellectuelles les plus remarquables, en tout cas. À la fragile démesure de cette ville, dans des constats tristes soulignés d’œillades aiguës, il nous restitue les temps oubliés d’un Manhattan confidentiel.
Le voyage au coeur de chaque instant
On dit communément de certains auteurs qu’ils nous font voyager. Le cœur de Mitchell est en soi une destination, chacun de ses battements martelant son profond attachement à la Grosse Pomme. En le lisant, on apprend beaucoup sur l’âme de la célèbre mégalopole : ses petits destins, surtout ; le murmure de chaque brique dont il était l’inattendu collectionneur. Je recommande chaudement la biographie de Thomas Kunkel, « L’homme aux portraits », pour comprendre tout ce qu’il y avait de fascinant chez lui.
L’homme du port
Mais là, je tenais à parler de son style si particulier. On sait qu’on n’a pas affaire à un auteur inoffensif, en débutant « Le fond du port ». Pas le genre à porter des coups violents, mais plutôt capable de travailler son lecteur en finesse, pour le mettre knock-out d’un bonheur incertain. Il parle de tout et de rien, notre étrange Joseph. Les détails sont faits pour lui. Nous faire apparaître un vieux patron de café sous divers jours lui est facile ; comme de parler avec éloquence d’un cimetière, et se montrer en mesure qu’on lui emboîte le pas dans des allées fleuries : « Mais invariablement, pour une raison que j’ignore et que je tiens à continuer d’ignorer, après avoir passé environ une heure dans un de ces cimetières à regarder les ornements de ces tombes, à en lire les inscriptions, à identifier les fleurs sauvages, à faire détaler les lapins cachés dans les mauvaises herbes et à penser à cette fin qui m’attend comme elle nous attend tous, je suis envahi par une certaine joie et pars dans une longue promenade. »
La vie grouillante partout
Ce territoire des morts est grouillant de vie, sous sa plume si digeste. Il photographie sa réalité en quelques mots empreints de l’insouciance des gens perdus, jetant ses pensées dans des corbillards. Son regard de journaliste capte tout ; il imagine le meilleur des assemblages pour que ce dont il semble être le dépositaire soit perçu de façon optimale, à son lent rythme d’observateur érudit.
Des phrases simples, souvent. Abreuvées de la philosophie d’un homme songeur, doté d’une vue d’ensemble sur son époque comme peu en sont bénéficiaires. C’est à la fois le fleuve Hudson et l’Atlantique, Mitchell : des courants faussement paresseux et la houle des sentiments ombrés de sa Skyline personnelle, ces choses qu’il avait en tête et qui l’assombrissaient parfois.
« Là-haut dans le vieil hôtel » commence ainsi : « De temps en temps, quand je cherche à me chasser de l’esprit certaines pensées sinistres ou trop mortifères, je me lève de bonne heure et descends au marché aux poissons de Fulton Street. »
Il avait ses tristesses et quelques refuges pour les accueillir.
Lisez ce que Mitchell a été pour New York. Rares sont les écrivains qui bâtissent ce qu’on ne peut visiter, et dont on se souvient pourtant aussi durablement que l’Empire State Building.
Lisez Mitchell. Vite.
Voir d’autres chroniques littéraires
– Ces livres qui vous choisissent
– Bojangle ou la folie d’un jazz en salle d’attente
– Pourquoi John Irving est-il si génial ?
Le mystère Joseph Mitchell
« Joseph Mitchell est passé à la postérité pour la manière dont il rendait compte de la vie des marginaux et des invisibles de New York. Clochards, patrons de bar, Gitans. Il a été l’un des plus grands journalistes de son époque.
Joseph Mitchell (1908-1996) passa près de trente ans à la rédaction de son journal sans rien publier.
Il n’y arrive plus. Il se rend chaque matin à la rédaction du New Yorker, se débarrasse de son manteau, s’installe à son bureau, se penche sur ses nombreuses notes mais rien de concret ne sortira plus du cliquetis de sa machine à écrire durant trente ans. L’un des plus mythiques reporters de l’histoire du journalisme américain ne publiera plus de récit à partir de l’année 1964, sans que l’on puisse fournir de véritables explications. »
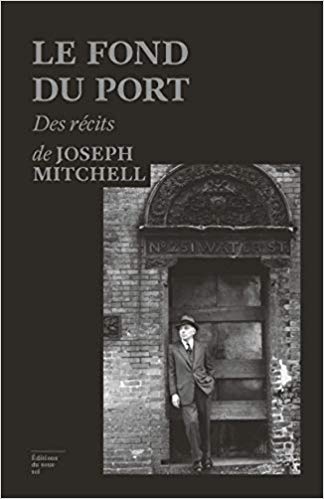
Dedalus du Lower East Side, Joseph Mitchell a su peindre les rues du vieux Manhattan comme retranscrire la drôlerie désespérée de sublimes anonymes bringuebalant l’Histoire dont ils sont les héritiers.
Chacun de ses caractères entonne tour à tour son aria : le patron d’un restaurant, le marin-pêcheur, l’ostréiculteur, le prêcheur composent l’oratorio d’une cité en perpétuel mouvement. La déambulation hasardeuse de l’arpenteur urbain est à l’image de ses digressions fulgurantes : imbriquées les unes dans les autres comme les blocks aux quartiers.

Joe Gould est un joyeux lutin émacié qui hante les cafétérias, les bistrots, les bars et les gargotes de Greenwich Village depuis un quart de siècle. Il se vante parfois, non sans un sourire forcé, d’être le dernier des bohèmes. «Tous les autres sont restés en rade, dit-il. Les uns sont au cimetière, les autres chez les fous ou encore dans la publicité.»
La vie de Gould est loin d’être exempte de soucis ; il est constamment aux prises avec trois fléaux : l’absence de toit, la faim et la gueule de bois.
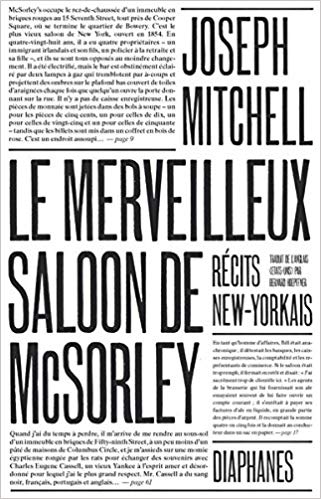
Recueil de textes inédits en français, écrits entre 1938 et 1955 par l’un des inspirateurs du nouveau journalisme. Publiés initialement dans le New Yorker, ces portraits à la qualité littéraire inégalée dessinent le tableau animé d’un New York populaire désormais disparu.

Mitchell s’installe à New York en 1929 et devient reporter. D’abord pour le World et le Herald Tribune, puis le mythique New Yorker. L’attention au détail, le sens de la construction, l’art de l’inventaire, Joseph Mitchell éleva le reportage au rang d’art. Les lecteurs chérissaient ses papiers peuplés de marginaux, ses esquisses de portrait d’un clochard céleste, d’un roi des gitans, d’une tenancière de cinéma à dix cents, de dockers, de piliers et patrons de bar, de passants mélancoliques et de fiers-à-bras.
