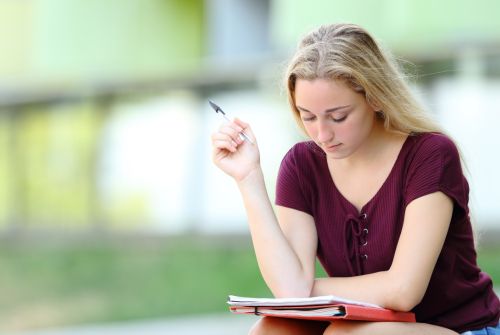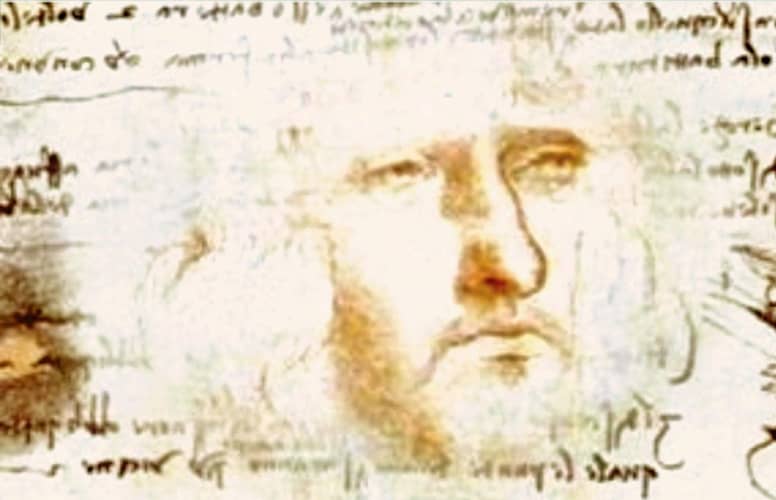Première partie
Vous avez souvent dû lire ou entendre la formule suivante : écrire, c’est réécrire. Un écrivain chevronné considère cette étape indispensable à sa méthode de travail. À juste titre, car elle alimente son processus créatif. Il arrive en revanche qu’un auteur débutant sous-estime l’importance de la réécriture et n’y consacre qu’une attention mesurée, voire un effort trop léger pour donner du poids à ses idées. Réécrire ne se limite pas à un toilettage superficiel du texte, mais bien à la clarification de notre pensée, et par-là, au renforcement de notre propos…
Le talent naît des modifications
La virgule et le domino
Il existe diverses raisons pour lesquelles on se montre inconsciemment réticent au fait de retravailler son texte en profondeur. Chez certains auteurs en herbe, il peut s’agir de la crainte – non fondée – de voir leur spontanéité menacée par une approche plus construite de leur écriture. Ou bien la certitude que remplacer une phrase ou même un mot reviendrait à pousser le domino voyant tout leur bel édifice littéraire s’effondrer. Bref, hormis supprimer la célèbre virgule d’Oscar Wilde – et comme le génial auteur irlandais, à condition de la remettre –, ne toucher à rien serait le meilleur changement à effectuer !
« J’ai travaillé toute la matinée à la lecture des épreuves d’un de mes poèmes et j’ai enlevé une virgule. Cet après-midi, je l’ai remis. »
Oscar Wilde
Une correction sans affect
Là où Wilde faisait preuve d’une autodérision mordante sur son perfectionnisme, d’autres mettent beaucoup trop d’affect quand il est seulement question de réfléchir aux meilleures façons d’améliorer son texte. Or, on doit s’en détacher émotionnellement quand on le réécrit. Les techniques que nous allons aborder dans cet article garantiront à ceux consentant à les utiliser une réelle progression dans leur écriture. Bien sûr, cela suppose d’admettre en préambule qu’une modification n’est pas le signe d’un échec, mais bien un pas vers le succès.
Ce qui compte avant tout
Ayez à l’esprit qu’avant toutes choses, vous devez proposer à votre lecteur une lisibilité de tous les instants. Le moyen de lui offrir une histoire facile d’accès doit tenir compte de ce qu’il redoute : qu’on lui encombre l’esprit de phrases trop longues. Qu’il doive les relire pour en saisir le sens. Qu’il s’embrouille dans votre confus étalage. En résumé, qu’il soit obligé d’accomplir l’effort de resserrement que vous n’avez pas estimé nécessaire d’effectuer. On m’objectera toujours : « Et Proust, alors ? » ; Eh bien quoi, Proust ? On n’est pas tous comme Pagnol, à se prendre pour Marcel, si ? Bref – c’est le mot à retenir.
Deux en une ou une en deux ?
La longue route vers l’essentiel
Au passage tout de même, si j’ai évoqué Proust, c’est bien pour ne pas condamner systématiquement les phrases parce qu’elles sont longues. Tout en reprochant à beaucoup qui le sont d’être ennuyeuses. Ou absconses. Ou les deux. Je reconnais par ailleurs volontiers que même des phrases courtes parviennent à cumuler cette double tare, ce qui m’incite à croire que certains le font exprès ! L’un des talents de Proust était, tout en étirant son propos, d’aller cueillir l’essentiel. On en obtient une preuve éblouissante en se rendant Du côté de chez Swann :
Un jardin extraordinaire
« J’ai vu le jardin. Il était tel que je l’avais rêvé enfant. » est une ébauche de ce qui deviendrait, dans les pages définitives du roman : « Je retrouvais le jardin que j’avais rêvé enfant, ce jardin devenu plus vaste encore sous l’éclat de ma mémoire. » De deux phrases assez communes, il en fit une au style remarquable. J’allais justement vous proposer d’accomplir le chemin inverse. Une sorte de transition contradictoire, si l’on veut !
La lecture sous oxygène
Vous connaissez Flaubert, et son fameux gueuloir. Vous voyez donc là où j’aimerais en venir : à la lecture à voix haute de vos phrases. Commencez par ça. Si on doit vous placer sous tente à oxygène au beau milieu de l’une d’entre elles, il y a fort à parier qu’elle soit un brin longuette. L’entendre résonner à vos oreilles vous en persuadera vite. Ce qui rend une phrase plus percutante réside dans son découpage, le choix des mots, la recherche de rythme. Il est parfois préférable de privilégier deux phrases courtes à une longue, sans rien perdre de son contenu, comme je m’y suis essayé ci-dessous :
« Il n’avait rien eu d’autre à faire qu’à transporter le cadavre jusqu’à la voiture, en ouvrir le hayon, puis disposer le corps à l’intérieur avant de rabattre le coffre en prenant soin de ne pas le claquer pour éviter de faire du bruit. »
« Il n’avait eu qu’à transporter le cadavre jusqu’à la voiture et à en soulever le hayon. Une fois le corps disposé à l’intérieur, il avait rabattu le coffre presque sans un bruit. »
« Il avait transporté le cadavre jusqu’à la voiture et soulevé le hayon. Rabattre le coffre sur le corps disposé à l’intérieur s’était fait sans bruit. »
« Le transport du cadavre, l’ouverture du hayon, le coffre refermé discrètement… la voiture semblait avoir englouti le corps en une bouchée. Sans déglutir. »
Racler le texte
J’ai procédé le plus simplement du monde. Par raclements successifs sur la chair du texte. Avant ça, j’ai mis dans la phrase de départ tous les éléments que je souhaitais y voir figurer. Puis, tout en les conservant, je l’ai scindée en deux afin de diminuer cette sensation d’accumulation qui l’alourdissait. Enfin, je l’ai élaguée pour conférer davantage d’énergie à l’ensemble. La quatrième version propose un style plus affirmé, la voiture paraissant presque douée d’une vie propre… et être particulièrement vorace ! La ponctuation bien huilée fait jouer les charnières du coffre sans, je l’espère, le moindre grincement.
Les errements sublimes
L’éducation à la précision
Je parlais de Flaubert ? L’exemple suivant est l’ébauche d’une phrase destinée à L’Éducation sentimentale :
« Il marchait lentement dans les rues de Paris en pensant à elle. »
Le brillant écrivain se contente de poser les éléments de ce qu’il fera ensuite ressentir au lecteur sous sa forme publiée :
« Il errait dans Paris, la pensée pleine d’elle. »
Quand Flaubert se sublime
La différence entre ces deux versions démontre combien la précision d’un verbe et l’allègement lexical qui en découle, le tout servi par une ponctuation pertinente, subliment la première mouture flaubertienne. Ces changements dynamisent en la poétisant une phrase déjà courte à l’état de brouillon. Le remplacement du verbe permet à la fois la disparition de « lentement » et de « les rues » tandis que le rythme gagne en harmonie et la sonorité en élégance.
Le hors-d’œuvre idéal
C’est en s’attachant à la concision et à la justesse du vocabulaire que l’inutilité de certains mots apparaît. Par comparaison avec « Il errait dans Paris », « Il marchait lentement dans les rues de Paris » semble d’un coup empreint de lourdeur et de platitude. Cette montée en gamme du style s’effectue sans ostentation. L’équilibre des segments donne le sentiment que la virgule entre les deux fluidifie l’ensemble plutôt que de séparer les éléments la constituant.
C’est, dans un premier temps, l’objectif qu’on doit se fixer lors d’une réécriture : rendre son texte le plus digeste possible. Le hors-d’œuvre idéal afin de ne pas caler sur le plat de résistance que nous mitonnerons dans la seconde partie de cet article…