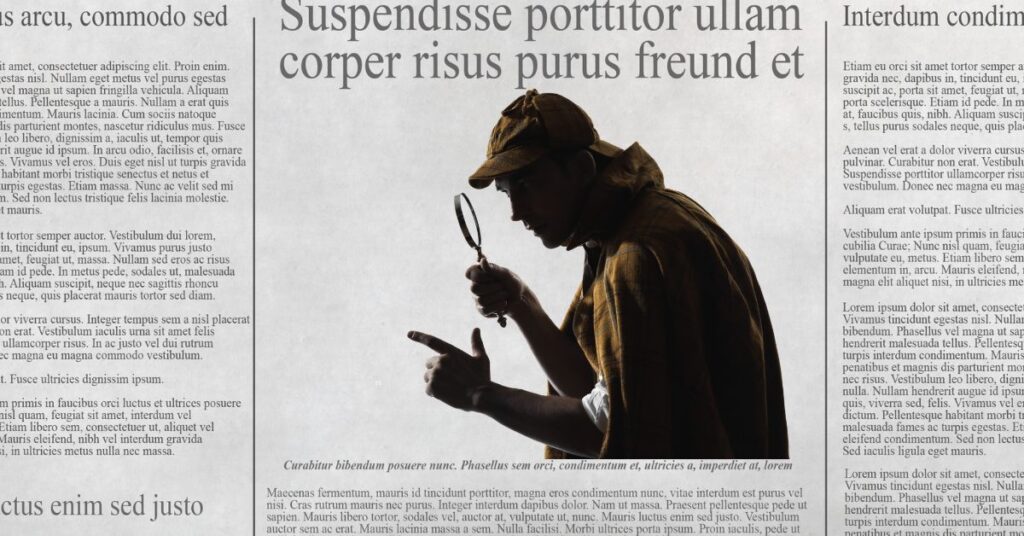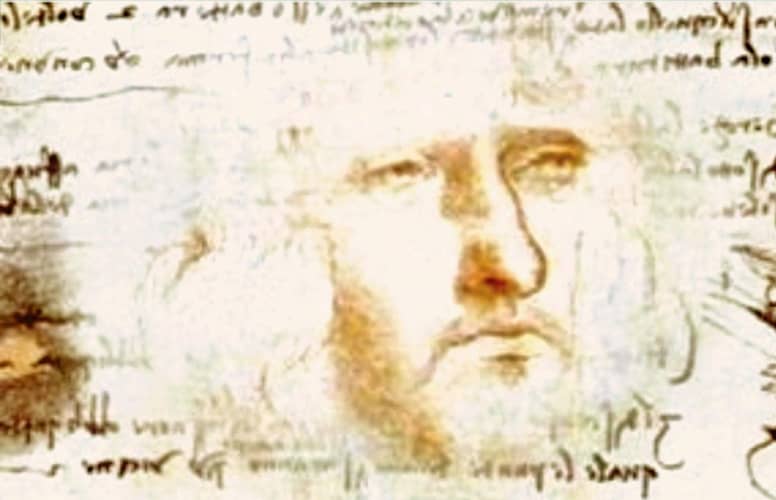Deuxième partie
On l’a vu dans la première partie de cet article, créer une situation marquante est un passage obligatoire afin qu’un personnage s’impose instantanément à l’esprit du lecteur. Dire que Sir Arthur Conan Doyle s’est particulièrement illustré dans cet exercice serait un euphémisme. Pour le sujet qui nous intéresse, il va de soi que l’analyse de la scène introductive présentant Sherlock Holmes s’avère d’un grand intérêt. Enquêtons donc sur l’avènement d’un phénomène littéraire – vous avez dit indices, vous avez dit preuves ?…
Et Conan Doyle créa Holmes
Hors des sentiers battus
En 1887, Dans Étude en rouge, Conan Doyle créa un personnage dont il ignorait encore qu’il marquerait la littérature au-delà du genre dans lequel il s’inscrivait. Grâce à Sherlock Holmes, il allait non seulement inventer une icône des amateurs de fins limiers, mais s’apprêtait aussi à redéfinir les codes de l’intrigue policière. Tout comme son héros se plaisait à égratigner les méthodes d’investigation jugées trop traditionnelles de Scotland Yard, l’écrivain écossais fut l’un des précurseurs proposant une narration s’éloignant des procédés conventionnels.
Dans la fumée de Holmes
La façon d’amener la scène où Holmes apparait pour la première fois repose sur une discussion. Elle a lieu entre Watson, qui s’enquiert de trouver à Londres un appartement « où se loger confortablement à bon marché », et Stamford, un ex-infirmier qu’il avait autrefois eu sous ses ordres dans l’armée. Coïncidence, ce dernier lui apprend que Watson est le second ce jour-là à lui poser cette question. C’est donc tout naturellement que la conversation dérive vers Holmes, dont on n’a pas encore vu fumer la pipe…
L’hameçon de Conan Doyle
D’une situation classique va émerger un procédé narratif prenant sa force dans l’évocation d’un personnage avant son entrée en scène. Ainsi Stamford prévient-il Watson, ravi à l’idée de partager en deux le prix d’un loyer, du caractère particulier de celui qu’il lui propose de rencontrer : « Si vous connaissiez Sherlock Holmes, dit-il, vous n’aimeriez peut-être pas l’avoir pour compagnon. » En une phrase, on apprend le nom du héros qu’on nimbe aussitôt d’une aura intrigante. Le lecteur est ferré, et Conan Doyle n’a plus qu’à tirer doucement sur sa ligne.
La rencontre
L’homme qui battait les cadavres
Comme à la pêche, il maintient une tension constante sur ce fil narratif afin d’empêcher qu’on décroche de l’histoire. On va le voir plus loin, le personnage de Watson est notamment le prolongement du lecteur, satisfaisant ici sa curiosité en se chargeant de questionner Stamford sur l’humeur de Holmes :
« […] Est-elle si terrible ? Parlez franchement.
— Il n’est pas facile d’exprimer l’inexprimable ! […] Voilà sa marotte : une science exacte, précise.
— Il y en a de pires, non ?
—Oui, mais la sienne lui fait parfois pousser les choses un peu loin… Quand, par exemple, il bat dans les salles de dissection, les cadavres à coups de canne, vous avouerez qu’elle se manifeste d’une manière pour le moins bizarre !
— Il bat les cadavres ?
— Oui, pour vérifier si on peut leur faire des bleus ! Je l’ai vu, de mes yeux vu. »
Entre deux éprouvettes
Ces propos sont échangés quelques instants avant que Watson découvre enfin, au cœur d’un laboratoire de chimie situé dans l’aile d’un hôpital, à quoi ressemble cet étrange individu. Voici le passage raconté par Watson et précédant la naissance du célébrissime duo :
« C’était une pièce haute de plafond, encombrée d’innombrables bouteilles. Çà et là se dressaient des tables larges et peu élevées, toutes hérissées de cornues, d’éprouvettes et de petites lampes Bunsen à flamme bleue vacillante. La seule personne qui s’y trouvait, courbée sur une table éloignée, paraissait absorbée par son travail. En entendant le bruit de nos pas, l’homme jeta un regard autour de lui. Il se releva d’un bond en poussant une exclamation de joie :
‘‘Je l’ai trouvé ! Je l’ai trouvé !’’ cria-t-il à mon compagnon en accourant, une éprouvette à la main. »
Ce qu’a trouvé Holmes est, selon lui, « la découverte médico-légale la plus utile qu’on ai faite depuis des années ! », ce qui résume à la fois le génie du personnage et sa modestie proverbiale. À partir de cet instant, Watson n’aura de cesse de tenter de percer le mystère que représente pour lui un homme dont l’esprit brillant le déroutera plus d’une fois. C’est ainsi qu’en espérant trouver un logement pas trop onéreux, Watson fit la connaissance de celui dont il allait faire un mythe.
Le regard de Watson
L’œil du lecteur
C’est là que réside une partie du succès de Conan Doyle : la présence d’un narrateur très incarné mettant en valeur le héros sans être cantonné au rôle de faire-valoir. Ce bon docteur est donc, en tant que narrateur interne, l’œil du lecteur. Et ce regard posé sur le détective lors de leur rencontre initiale amorcera toute la structure du canon holmésien. Autant dire combien est importante cette « prise de contact narrative » tant dans son approche que dans sa construction. Non seulement Conan Doyle trouve en Watson un conteur toujours situé aux premières loges, mais aussi un fin observateur confronté à ses propres limites. Et ce dernier point n’est pas anodin…
Des limites communes
En effet, Les limites de Watson, ce sont aussi celles du lecteur « moyen » placé devant l’évidente supériorité cognitive de Holmes. Ainsi, tout comme Watson, il oscillera entre l’admiration et parfois l’agacement quand le détective étalera ses compétences déductives hors du commun avec l’arrogance dont il sait si bien faire montre à l’occasion. Néanmoins, on retiendra surtout combien le point de vue privilégié du docteur fait ressortir tout le génie de son fameux colocataire.
Une balance affective
Ce schéma où le personnage de Watson tend un miroir à celui de Holmes offre au lecteur un point de comparaison humain. Ainsi une vision d’ensemble s’élabore-t-elle entre le côté émotionnel et empathique du docteur s’opposant à la froideur et à la rationalité du détective. Les plateaux de cette balance affective trouvent leur équilibre dans la complémentarité et la complicité des deux hommes au-delà de ce qui les distingue, relation ambigüe alimentant en permanence l’œuvre de Conan Doyle.
Indissociables
Un trio compliqué
Au final, tous les ingrédients d’une scène marquante sont articulés pour qu’en émergent non pas un, mais deux personnages littéraires. Si l’un est probablement plus « adulé » que l’autre, il n’en demeure pas moins qu’ils restent indissociables et appartiennent chacun à leur niveau à la pop culture. Le grand oublié de cette histoire serait presque Conan Doyle lui-même, la figure de
Holmes ayant dépassé celle de son auteur…
L’ultime déduction
Pourtant, la conclusion de l’excellente préface de Étude en rouge par Germaine Beaumont (première femme à obtenir le prix Renaudot pour Piège, oui quand même) initie une réflexion rendant à Doyle ce qui appartient à Holmes : « Sherlock Holmes n’a pas de descendance. Il m’apparaît comme un homme qui aurait écrit un livre prodigieux intitulé Conan Doyle. »
Tout comme Sherlock, vous en déduirez ce que vous voudrez…