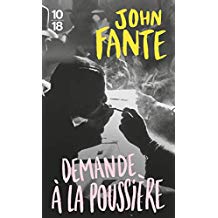John Fante. Une chronique de Frédéric Barbas au sujet du roman Demande à la poussière.
« Dans les années trente, Arturo Bandini, fils d’ immigrés italiens, quitte le Colorado pour l’Eldorado, Los Angeles, avec son unique roman en poche et un rêve : devenir un écrivain reconnu. Vénérant les femmes et la littérature, il débarque dans une chambre d’hôtel miteuse, prêt à saisir la vie à bras-le-corps. Une errance sublime parmi les laissés-pour-compte du rêve américain. »
Vous allez défroisser vos idées
Un écrivain qui veut comprendre son métier doit lire ce livre au moins une fois. Vous n’y trouverez pas des trucs infaillibles pour réussir dans la partie, mais vous entendrez une voix qui vous parle, à vous que l’envie de bazarder ordinateur, papier et stylo par la fenêtre a traversé l’esprit plus d’une fois.
En s’adressant à notre cœur littéraire, celui dont chaque battement est un mot sur une page, Fante fait pulser sa passion enfiévrée en nous. Et nous guide à sa façon brutale et désenchantée vers qui prend la plume doit parfois accomplir : faire de sa suffisance des boules de papier, puis avoir l’imbécile orgueil de les défroisser, pour les jeter plus loin. Et recommencer sans fin.
Ce qu’un parcours d’auteur nous apporte n’est pas quantifiable, chacun y puisant une ressource ou une autre, un élément de progression en tout cas. J’ai découvert cet auteur sur le tard, c’est le moins qu’on puisse dire, puisque Demande à la poussière a été publié en 1939. Le personnage central/narrateur, Arturo Bandini, occupe trois autres romans de Fante, comme je l’ai appris en effectuant quelques recherches sur cet écrivain, chose que je fais systématiquement, désormais.
Savoir comment on devient écrivain
Je conseille vivement à chacun de procéder ainsi, ça permet de voir par quoi certains passent pour construire leur œuvre, quelle est la source de leur détermination, si leur carrière littéraire était plus ou moins ancrée (ou encrée, pour le coup) dans leur ADN ou s’il s’est agi d’un miraculeux accident de parcours. Bref, c’est souvent plaisant et instructif. Autant que dans les méthodes pratiques d’écriture, il m’apparaît très précieux d’investir dans des biographies de femmes ou d’hommes qui tiennent le haut du pavé dans le domaine qui nous intéresse.
Demande à la poussière, préfacé par Bukowski (un autre rude, celui-là !) dans l’édition 10/18, est un bouquin remarquable par l’énergie geignarde, ou la rage triste, si de telles chose existent, qui le parcourent de la première à la dernière page. Il semblerait facile de créer un héros torturé en lisant Fante, tant tout paraît évident une fois qu’il l’a écrit, mais cette aisance est trompeuse, car on le sait, rien n’est plus compliqué que de faire simple.
Pour qu’on puisse comprendre de quoi je parle, et je le ferai chaque fois que je commenterai un roman, j’ai choisi de proposer ce qu’il me semble être quelques phrases significatives du style et de la pensée de l’auteur. Les voici, en commençant par les premières du bouquin :
« Un soir je suis assis sur le lit dans ma chambre d’hôtel sur Bunker Hill, en plein cœur de Los Angeles. C’est un soir important dans ma vie, parce qu’il faut que je prenne une décision pour l’hôtel. Ou bien je paie ce que je dois ou bien je débarrasse le plancher. »
En lisant cette introduction, on comprend que Fante ne craint pas les répétitions (deux fois « soir » et deux fois « hôtel ») puisque faisant partie de l’urgence étudiée habitant son personnage qui se dévoile sans fioriture, avec le minimum de recul, et pourtant le discours qu’il se tient et qu’il tient au monde qui l’entoure porte loin.
En quelques mots, Bandini est situé, et pas que géographiquement : on comprend qu’il séjourne depuis un certain temps dans cet hôtel et qu’il est dans la dèche, et on le sent à l’aube d’une décision importante englobant quelque chose de plus grand que l’obligation de laisser sa chambre faute de pouvoir payer la note. On ignore encore si ce sera un personnage tragique, mais on suppose qu’il a des trucs intéressants à dire.
Le parler vrai en littérature
Fante doit être l’un des adeptes du clin d’œil au lecteur, avec Kesey peut-être, et bien sûr Butor, ou Kerouac d’une certaine façon, ( je n’oublie pas le merveilleux Frédéric Dard, spécialiste en la matière) chacun à leur manière. Le petit truc dans leur discours qui fait qu’on se sente tirer par la manche, comme pour nous dire : « Viens, j’ai vécu un truc, il faut que je t’en cause. » On pourrait appeler ça un caméo littéraire.
Ce vécu enfanté (même si Kesey n’a peut-être jamais franchi les portes d’un asile psychiatrique) laisse la trace profonde de qui a su verbaliser la boue de son existence, et l’exprimer avec une éloquence déglinguée : chassons ici les puristes, les superviseurs lexicaux, les piètres tatillons, car ils nous ennuient. C’est de souffrance hurlante, dont on parle, cette jolie gosse qu’on maquille au purin :
« J’ai sorti mon mouchoir pour m’essuyer les lèvres. Le mouchoir avait du sang dessus. J’ai suivi la grisaille du couloir, jusqu’à ma chambre. À peine j’ai fermé la porte que tout le désir qui m’avait fait défaut juste un moment auparavant s’est emparé de moi. Il me cognait le crâne et m’élançait les doigts. Je me suis jeté sur le lit et j’ai déchiré l’oreiller avec mes mains. »
On ne reproche pas à un écorché vif de saigner. On ne reprochera donc pas à Fante sa curieuse démesure, faite de petit pas, d’élans furieux et de questionnements morbides. Son énergie, en fait, qui nous le fait voir comme la personnification d’un étonnement indigné ou d’une errance sans fin.
L’étrange douceur d’une gifle de papier
La suite, faite d’introspection brutale, d’une quête amoureuse tant fébrile que désespérée, de la recherche de reconnaissance, de ce qu’un écrivain contient de désespoir, est contée dans un style nerveux, sec, jamais bavard, jamais économe, mais perpétuellement entre les deux. C’est presque une distribution de baffes. Refermer un bouquin en ayant la sensation d’avoir été giflé est assez rare.
Fante a ce chic des auteurs percutants dont il me semble que chacun devrait s’inspirer. Pas forcément pour calibrer son propre style, mais afin de voir quel effet ça procure de produire une littérature essorée.
Lecteur, on s’imagine capable de composer ces phrases sans fard, d’imprimer ce rythme entêté à notre histoire, et quand on s’y risque, du moins si l’on est honnête avec soi-même, on saisit que l’art d’un faux dénuement n’est accessible qu’au prix d’un long labeur. Qu’il faudra travailler dur et sans relâche pour donner l’impression d’un talent désinvolte.
Il y a de l’esbroufe chez Fante : ostentatoire, elle est si magnifiquement fabriquée (dans le sens noble de la manufacture) qu’on lui pardonne de nous avoir éblouis, jusqu’à en avoir les yeux rougis, avec de la poussière.
Demande à la poussière – John Fante.
![]()
Ces articles peuvent vous intéresser
Bojangles ou la folie d’un jazz en salle d’attente