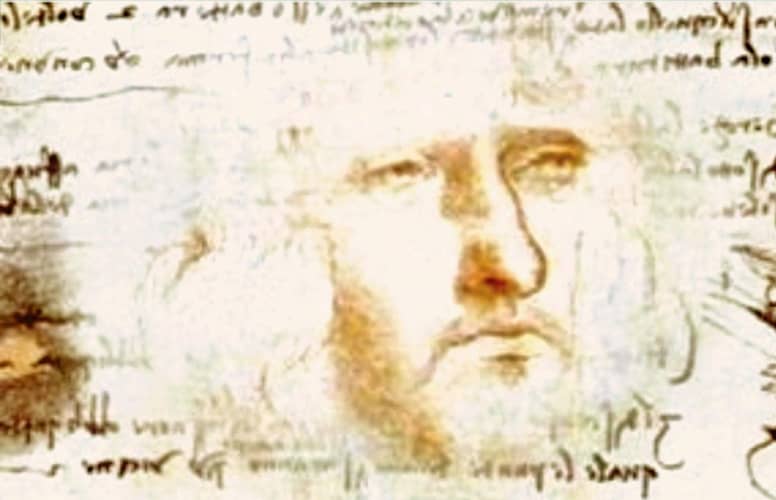Deuxième partie
On l’a vu précédemment, la métaphore est l’une des figures de style nourricières de l’écriture poétique. Elles donnent de la sève aux mots, de la vigueur aux idées et de l’originalité à l’expression. Si nous allons continuer à en étudier quelques-unes, nous ferons aussi un focus sur l’image, dont Antoine Albalat souligne une subtilité : « Une image n’est pas toujours une métaphore, mais une métaphore est toujours une image ». Allons observer ça de plus près sans passer par Épinal…
Quand McCarthy fait un arrêt sur image
Le style urgent
J’ai dégoté un exemple tout à fait épatant d’une image se muant en métaphore dans le tourneboulant bouquin de McCarthy, Méridien de sang. Respirez un bon coup avant de lire la phrase que j’ai sélectionnée, car ce bon vieux Cormac ne mettait des virgules qu’un flingue pointé sur la tempe, comme s’il s’agaçait de toujours devoir remettre en place cette mèche rebelle de la ponctuation. Ça donne parfois l’impression qu’il ne pouvait s’adresser à vous qu’avec une pointe d’urgence impérieuse dans la voix : « Eh vous, là, lisez-moi, et plus vite que ça ! »
L’identité de l’écrivain
Mais ne croyez pas que cela relève d’un caprice ou de maniérisme de qui voudrait se distinguer : ça participe de son identité d’écrivain, de la tension qu’il désirait introduire dans son récit. D’une proposition faite au lecteur, plutôt qu’un ordre, d’accorder son propre rythme – sa respiration visuelle – au sien. Certains de ses passages vibrent comme l’air dans la chaleur, d’autres procurent le sentiment que les mots cassent telles des branches mortes. Bref, voici la bête dans toute sa splendeur :
« Les montagnes déchiquetées étaient d’une teinte bleu pur dans l’aurore et partout les oiseaux gazouillaient et le soleil quand il parut surprit la lune à l’ouest et tous deux se faisaient vis-à-vis d’un bord à l’autre de la terre, le soleil chauffé à blanc et la lune sa pâle réplique, comme s’ils avaient été les extrémités d’un même tube au-delà desquelles brillaient des mondes qui défiaient l’entendement. »
P111 de Méridien de sang – Cormac McCarthy – Éditions de l’Olivier.
L’aurore d’une réflexion
« L’image a un champ plus large, englobant toute description vive et évocatrice, tandis que la métaphore implique spécifiquement un rapprochement implicite entre deux éléments. », dixit Albalat, toujours lui. L’aurore de McCarthy éclaire d’une lumière vive et évocatrice cette réflexion. Il suffit pour s’en convaincre de segmenter la phrase de l’écrivain américain ; elle caracole jusqu’à la première virgule à dos d’image, et met pied à terre dans la poussière d’une métaphore.
La phrase décortiquée
Basculer dans la poésie
L’image proprement dite commence par « Les montagnes déchiquetées » pour s’achever à « le soleil chauffé à blanc ». Ce segment-là contient une description classique, photographie d’un paysage sur lequel le jour se lève. Cette première partie, McCarthy l’a élaborée en positionnant les différents éléments du décor d’un seul trait. Cette suite de mots paraissant s’emballer trouve avec la virgule son point de basculement vers une vision poétique composée d’une métaphore et d’une comparaison.
Second souffle
L’expression « la lune sa pâle réplique » est une métaphore implicite, aucun mot n’effectuant le lien avec le « soleil chauffé à blanc » bien qu’ils soient indissociables par leur rapprochement sous-entendu. En revanche, le dernier segment de la phrase repose sur un élément de comparaison, car elle s’articule avec « comme ». Cela donne des deux astres l’image de chaque extrémité d’un tube. Une image, une métaphore, une comparaison, McCarthy nous gratifie d’une écriture poétique paraissant au bord de l’asphyxie mais qui respire la technique dès qu’elle reprend son souffle.
L’alexandrin vagabond
Un bouquet de métaphores
Bien qu’une image ou une métaphore puisse se suffire à elle-même, on peut en renforcer l’impact en travaillant sur le rythme à la façon dont McCarthy le fait, ou bien revenir aux bases de la poésie afin de conférer une certaine musicalité au texte. En s’appuyant sur l’existant, on s’aperçoit combien un alexandrin extrait de son poème d’origine pourrait s’intégrer harmonieusement à un roman ou une nouvelle. Autant s’attacher le génie de Baudelaire pour ce faire, aussi je me permets ici de subtiliser une fleur à son bouquet, le premier vers de L’ennemi, en l’occurrence :
« Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage. »
L’ennemi, dans le recueil Les fleurs du mal – Charles Baudelaire – Éditions Le Livre de Poche.
Les articulations poétiques
Cette métaphore pourrait constituer un puissant incipit comme verrouiller un paragraphe (ou un chapitre) en un effet saisissant. Son caractère définitif souligné par l’emploi du passé simple évoque une jeunesse tumultueuse perdue à jamais – de quoi clore magistralement un passage. Cet aspect révolu peut aussi se voir telle une volonté de faire table rase du passé pour prendre un nouveau départ, soit une phrase de transition idéale afin de progresser dans le récit. La poésie peut vagabonder d’un genre à l’autre, et ses vers devenir la soie de votre texte.
Cessez d’être invisible, devenez talentueux
Une dernière métaphore avant que l’on se quitte ? Je pense qu’elle va vous plaire. En tout cas, en quelque sorte, elle vous parlera. Et qui sait, peut-être vous encouragera-t-elle dans les efforts que vous consentez pour progresser dans votre écriture : « Le talent, c’est la grâce rendue visible. » Si vous êtes en train d’apprendre le métier d’écrivain avec L’esprit Livre, je pense que vous savez tout à fait de quoi Stephen King parle – cette phrase est de lui. De la grâce cachée dans les idées que vous ne parveniez pas toujours à exprimer jusqu’alors. Et de ce que ça implique : c’est en se découvrant qu’on devient talentueux…