première partie
S’adonner à un art avec passion ne garantit hélas pas de l’exercer avec brio. C’est d’autant plus dommage que cette réalité plonge souvent les auteurs en herbe dans le doute quant à leur capacité à proposer une écriture digne d’intérêt. Juger de la qualité de ses efforts littéraires n’est, il est vrai, pas chose aisée lorsqu’on peine à les évaluer avec objectivité. Faute de poser le bon diagnostic sur leurs difficultés, combien d’écrivains débutants ont-ils fini par céder au découragement et ont renoncé à leur vocation ? Ce n’est pas quantifiable, mais ça peut se résumer en deux mots : beaucoup trop. Alors que parfois, des conseils avisés leur permettraient de prendre conscience des blocages les empêchant d’exprimer leur potentiel…
L’autre écrivain
Bourbier et lac
Une des plaies empoisonnant les auteurs qui noircissent leurs premières pages réside dans l’existence des écrivains à succès. Eh oui ! Ceux-là mêmes donnant pourtant envie d’écrire, ce qui est bien, mais auxquels on a parfois tendance à se comparer, ce qui est ballot, surtout quand on en est encore à balbutier nos phrases d’une ligne à l’autre. Résultat, on estime que nos paragraphes ont l’aspect d’un bourbier lexical quand chez Hugo ou Bazin, Troyat ou Flaubert, on croirait se pencher sur la surface limpide d’un lac de montagne où se reflèteraient avec une splendide netteté les sentiments humains. Ô drame, ô désillusion, pleurs d’encre et neurones en flammes !
Le fossé avant le sommet
Bref, voilà le futur auteur fort marri en contemplant le sommet littéraire qu’il pensait si vite atteindre avant même d’avoir entrepris son ascension. La charrue avant les ours, la peau du bœuf avant de l’avoir tué, tous ces dictons plein de bon sens même quand ils sont mis dans le mauvais résonnent alors aux oreilles de celui mesurant le fossé le séparant de ses illustres modèles. On évitera donc d’établir trop hâtivement des comparaisons avec des écrivains dont le style a été mille fois ciselé dans le marbre de l’expérience.
Le temps d’apprendre
La tentation de s’étalonner en décortiquant ce qui se fait de mieux en littérature est légitime et source de progrès. Mais pour éviter de transformer une base d’apprentissage en une source d’inhibition, on doit dans un premier temps se positionner en tant qu’apprenant. L’erreur consistant à vouloir d’emblée égaler les tout meilleurs est un frein à l’épanouissement de nos capacités naturelles. On ne développe en effet pas ces dernières comme on le devrait si on les néglige en leur préférant des procédés ne pouvant s’acquérir sans un nécessaire processus de maturation. En quelque sorte, il faut prendre son temps pour s’améliorer le plus vite possible.
Atteindre l’équilibre littéraire
Racines et ressources
Comprendre l’apport constitué par la lecture et l’analyse d’écrivains talentueux – ou connaissant de vifs succès de librairie, ce qui n’est pas forcément la même chose – est une étape importante dans l’acquisition de techniques d’écriture. Le tout sans remettre en cause le travail que l’on accomplit en exploitant nos qualités propres. Ainsi se crée un équilibre où se nourrir du talent des autres fait croître le nôtre sans le dénaturer. Croyez-le, il est primordial de conserver les racines de notre identité littéraire tandis qu’on emmagasine des ressources lui étant extérieures.
Le génie démythifié
Quand on obtient ce savant dosage, une confiance neuve nous vient : celle des gens qui apprennent à apprendre. L’impression de ne pas être à la hauteur des écrivains que l’on admire s’atténuera à mesure qu’on s’appropriera leurs savoir-faire. La compréhension d’une écriture brillante démythifie cette vaste blague du génie instantané tout en préservant intacte l’émotion que nous procurent les plus grands romanciers. Ce n’est pas parce que l’on comprend comment un tour fonctionne que la magie n’opère plus : s’il est exécuté avec adresse et ingéniosité, l’émerveillement subsiste.

Celle que l’on redoute
Le baptême du feu
Il y a une étape aussi attendue que redoutée pour les auteurs. Les débutants tout particulièrement l’envisagent parfois avec une forme de crainte irraisonnée, ne sachant trop comment ils vont réagir lorsqu’ils vont y être confrontés. Il s’agit de ce baptême du feu qu’est la critique d’autrui. On n’hésite pourtant pas à soi-même se morigéner quand on relève dans notre texte une faiblesse stylistique ou une incohérence rédhibitoire pour la crédibilité de l’histoire. On se traite d’idiot, et même pire : d’écrivain raté. Les mauvais soirs. Puis l’on se jette des fleurs au vent des jours meilleurs.
La critique du saligaud
Mais que quelqu’un d’autre que nous s’avise de nous faire une remarque un peu piquante – croit-on – sur notre écriture, et nous voilà décontenancé, voire meurtri. On s’espérait brillant et un mot nous ternit. Du moins une suggestion au fond bien innocente prend-elle des proportions dont nous n’avions pas imaginé la portée avant de confier le fruit de rudes efforts à quelqu’un qui, évidemment, se contrefiche des heures de travail consacrées à notre texte. À ces quelques pages qu’il nous agite négligemment sous le nez en pointant un défaut après l’autre, ce saligaud !
Sacré Winston !
Nous verrons la semaine prochaine pourquoi cette remise en cause de nos qualités, sous des dehors dévastateurs, est salutaire pour combattre le doute auquel chaque auteur est un jour ou l’autre confronté. Pour cela, on ne doit pas laisser notre orgueil empiéter sur notre intelligence. Ainsi, on finit toujours par comprendre que la voie du succès comporte souvent quelques détours un peu ardus que nous serions pourtant bien inspiré d’emprunter. Car au final, il s’agit de précieux raccourcis vers l’amélioration de notre écriture. Churchill a eu ces mots dont l’éternelle pertinence n’échappera à personne : « L’orgueilleux aimera mieux se perdre que de demander son chemin. » Sacré Winston !

Vous pourriez aussi aimer :




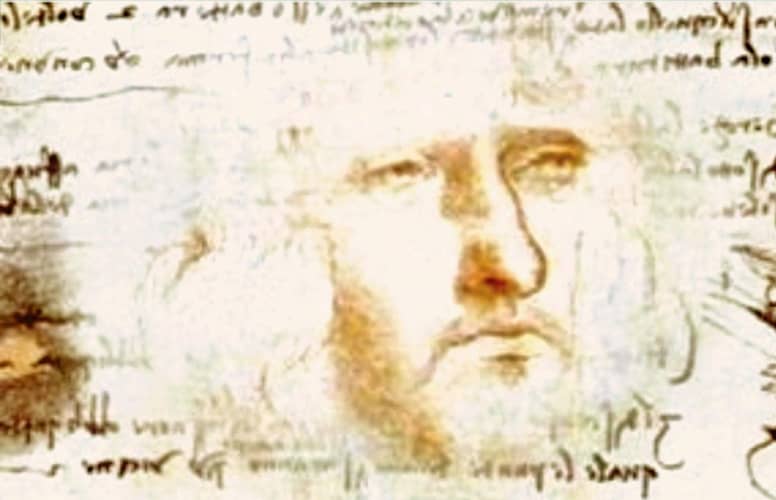

2 réflexions sur “Ne doutez plus de votre écriture”
C estavec intérêt que j ai lu ce commentaire, qui me ramène à mon enfance lointaine ou j ai essayé d écrire. Mainte fois j ai noirci des pages que j ai détruit ensuite. Pourquoi? Par timidité, par orgueil, par peur je ne sais. Mais ce que j ai appris, c est que ce comportement a été reporter sur toutes mes action dans ma vie. Certaines ont été des réussites, mais trop peu. Pourquoi? En conduisant je tenais des discours qui me plaisait, mais si je voulais les mettre par écris, ils devenaient fades. A 78 ans seulement, je peux mettre des mots sur ce manque,, le doute et la confiance en soi. Peut être ai je trouver le mal! Je ne sais.
Bonjour Michel,
Je comprends ce cheminement intellectuel forgé dans l’incertitude et le renoncement. Les sentiers qu’emprunte une personne désireuse d’écrire sont souvent semés d’embûches, je ne vous apprends rien ! Néanmoins, si vous avez peut-être enfin trouvé les ressources pour mettre des mots sur vos pensées, je ne peux que vous encourager à persévérer !
Bon courage pour continuer dans cette voie-là !